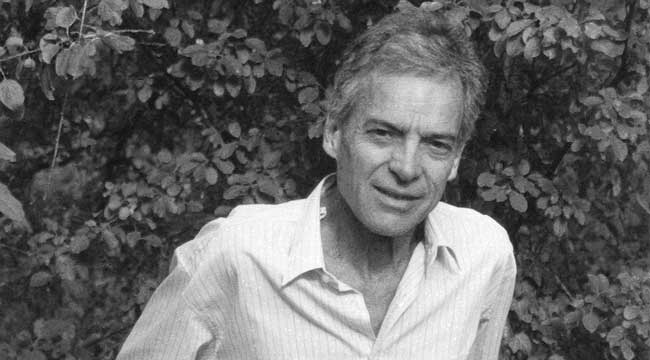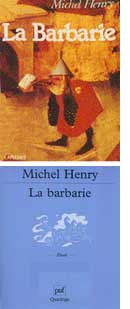 La Barbarie, 1ère ed. Grasset,
1987
La Barbarie, 1ère ed. Grasset,
1987
Notre monde ne va
pas bien et cet essai brillant et passionné a hélas encore
gagné en actualité. Lors de sa publication, alors que de
leur côté des biologistes s’interrogeaient sur l’orientation
éthique de la science, il a connu un grand succès. Son propos
est de prendre en vue la catastrophe majeure de notre temps, la barbarie
et de mettre en lumière sa cause : on ne saurait y voir un fléchissement
ponctuel de civilisation comme il y en a tant eu. Il s’agit, montre
M.H., d’une dénaturation de la vie tout entière dont
l’essence est de faire effort pour se transformer et s’accomplir.
Inversion de ce processus, la barbarie résulte de la progression
aveugle de la technique, généralement considérée
comme positive.
C’est sur les principes de sa phénoménologie que M.H.
fonde son analyse d’une catastrophe qui touche en réalité
à l’historial. La crise actuelle lui fait définir
la relation de la culture à la vie, la nature de la science, celle
de la technique, ainsi que celle de la communauté, de la société,
du travail, le tout en faisant retour au concept central de cette phénoménologie
lequel définit l’état de tout sujet, l’auto
affection. Ce texte est un manifeste en faveur de la vie et non le pamphlet
que certains ont cru lire. Ici aussi la description de ce texte serré
ne peut que restituer son mouvement général et situer ses
analyses.
Ce qui ne s’était jamais vu :
Alors qu’auparavant au déclin général d’une
culture et d’une civilisation succédait une reprise grâce
aux forces internes de l’homme qui fondent son activité économique,
artistique, intellectuelle, morale, religieuse, on assiste aujourd’hui
à un déséquilibre. Le développement sans précédent
des savoirs scientifiques va de pair avec l’effondrement des autres
activités. L’explosion scientifique entraîne la ruine
de l’homme.
Ch. I : Culture et barbarie
Produit de l’auto transformation spontanée de la
vie, la culture est un savoir originel, subjectif, de la vie. Ce savoir
diffère du savoir scientifique, objectif, tel que l’a formulé
au XVIe siècle Galilée, fondateur de la science moderne.
Ce savoir repose sur l’abstraction des qualités sensibles
du monde pour ne retenir que les formes abstraites de l’univers
spatiotemporel c’est-à-dire des significations idéales,
comme l’a bien vu Husserl. C’est pourtant la vie subjective
qui donne originairement forme au monde de la vie, tandis que, dans la
mesure où la conscience est pouvoir de faire voir, de se rapporter
à des objets, elle fonde l’objectivité. Il faut toutefois
aller au-delà de Husserl. La vie en réalité est exclusive
de toute relation à un objet. C’est un savoir qui s’identifie
à ce qu’il fait, opère du dedans et qui se confond
avec son pouvoir. Bien qu’il soit la condition interne du savoir
scientifique, le savoir de la vie ne voit rien. Descartes avait déjà
compris que l’idée d’ipséité n’a
pas d’objet, que l’esprit est pouvoir originel de révélation.
La science repose donc sur une double abstraction : 1 - une mise hors
jeu des qualités sensibles et des prédicats affectifs, ce
qui est légitime quand on vise à l’universalité.
2 - l’inconscience des limites de son champ de recherche. Elle n’a
aucune idée de la vie, ne s’occupe que du milieu d’extériorité
pure qu’est le monde, le « toujours dehors », l’objet
qui n’est pas vivant. N’ayant aucun rapport avec la culture,
se mouvant dans la théorie, elle ne peut concevoir l’aspect
purement pratique de celle-ci. En effet, qu’elle soit grossière
ou raffinée, la culture est toujours pratique – définition
qui rejette la distinction culture / civilisation, souvent objet de débats.
La subjectivité est tout entière besoin. Cette praxis revêt
des formes élémentaires – biens utiles à la
vie, nourriture, habitat, célébration de son destin, érotisme,
organisation sociale, lois de la vie, travail. Elle satisfait surtout
des besoins supérieurs, art, éthique, religion. Comment
« ce Désir de la vie, ce désir de soi » a-t-il
pu s’inverser ?
Ch. II : La science jugée au critère de
l’art
Constater que la science se développe hors de la sphère
de la culture n’est pas la condamner. Ce n’est pas le savoir
scientifique qui est en cause, mais l’idéologie actuelle
qui le tient pour l’unique savoir. M.H. choisit une ingérence
de la méthode scientifique dans le domaine de l’art pour
rendre sensible leur hétérogénéité
– et la barbarie qui en découle. L’art est affectif
en son fond, « il entre en résonance avec le monde dont tout
homme en tant qu’habitant est potentiellement artiste ». A
Eleuthère, ancienne forteresse grecque dont les remparts cyclopéens
magnifiquement conservés sont défigurés par une ligne
électrique à haute tension, à Daphni, vieil édifice
orthodoxe dont les mosaïques font l’objet de destruction quand,
anciennement restaurées à l’identique après
un séisme, elles ne datent pas de la même époque que
celles d’origine. D’un côté méfait de
l’ignorance, de l’autre méfait de la prétendue
science dans un domaine qui n’est pas le sien. Un monde par essence
esthétique cesse ainsi d’obéir à des prescriptions
esthétiques. Car il n’existe pas de totalité objective
qui s’appelle le monde, celui-ci ne doit son unité qu’à
la sensibilité individuelle. « L’individu est le tout
de l’être ».
La science ne tient pas compte de ces lois. D’où les horreurs
du monde moderne et les ravages des prétendues restaurations comme
à Daphni, basilique du XIe siècle dévastée
comme tant d’autres édifices de l’est de la Méditerranée
par Paolo Mora, mandaté par l’Unesco, sous prétexte
de « restaurations scientifiques ». Le sacrilège de
ces restaurations touche à l’unité organique du substrat,
analogon de l’objet esthétique qui est par essence imaginaire.
L’art est la représentation de la vie, c’est-à-dire
de l’invisible, et à chaque fois d’une essence subjective,
d’une ipséité individuelle car il n’est autre
que l’ensemble des figures de la vie, caractère qu’ignore
la science. (Se reporter à Voir l’Invisible, essai
sur Kandinsky, à reparaître prochainement dans Quadrige,
PUF).
Ch. III : La science seule : la technique
Quelle est la parenté de la science et de la technique
?
La science repose sur une abstraction de la sensibilité donc de
la vie. Son illusion, qui lui permet de réduire le monde de la
vie, est de croire que les qualités sensibles sont celles du monde
objectif, alors que celles-ci ne sont que l’objectivation, la re-présentation
d’une impression qui prend son origine dans la subjectivité.
C’est ainsi que s’est instaurée une hégémonie
exclusive de la science qui se comporte comme si elle était en
droit de dicter sa loi au monde. Dès lors, dans la modernité,
la vie a cessé de se donner à elle-même ses propres
lois. La science en effet est devenue technique, ses opérations
puisant exclusivement leur possibilité dans un savoir théorique.
Quelle est l’essence de la technique ? Certains veulent voir dans
la technique moderne l’affirmation de la maîtrise de l’homme
sur l’univers des choses. Le progrès constituerait cette
réalisation progressive présentée comme fin suprême
de l’humanité. Mais la science ni la technique ne savent
rien des intérêts supérieurs de l’homme. La
technique moderne ne repose de fait que sur l’auto développement
d’un savoir théorique livré à lui-même.
Or l’essence de la technè est la praxis,
le savoir-faire originel de la vie, singulier et individuel, l’expression
de la vie, la mise en œuvre de nos pouvoirs subjectifs, forme première
de la culture. Corps et Terre sont liés par une copropriation si
originelle qu’elle exclut tout dehors. C’est ainsi que nous
transformons le monde qui est le corrélat de notre mouvement –
que nous devenons propriétaires de la terre.
Or quand ce déploiement de la praxis devient représentation,
il y a bouleversement ontologique, l’action cesse d’obéir
aux prescriptions de la vie, devenue objective, elle se produit dans le
monde - usines, barrages, centrales, computers - de façon matérielle.
A cela s’ajoute une inversion identique de la téléologie
vitale dont Marx a reconnu les conséquences quand, se détournant
des valeurs d’usage, des biens utiles à la vie, la production
a visé l’argent, une abstraction. Le savoir s’est détourné
de l’action vivante, il est devenu l’apanage de la science.
Le rôle des travailleurs dans le monde moderne s’est amoindri,
remplacé par des robots. L’atrophie des potentialités
de l’individu vivant a entraîné un malaise –
et une inculturation. La part du savoir de chacun est devenue minimale.
La technique est devenue la nature abstraite, sans l’homme, barbarie
qui a évincé la culture qui était auto transformation
du vivant .La téléologie vitale est devenue économique
– tributaire de la consommation et de l’argent. L’univers
technique prolifère à la manière d’un cancer.
Il n’y a plus ni question ni conscience pour la science, seulement
sa réalisation objective, la technique.
Ch. IV : La maladie de la vie
C’est la subjectivité qui crée les idéalités
de la science. Comme celui de la culture son acte inaugural est une modalité
de la vie. Aujourd’hui toutefois la science et la culture sont en
rapport d’exclusion réciproque – ce qui suppose un
oubli : la science laisse s’échapper son propre fondement
– ce qui se passe aussi quand la philosophie réduit la subjectivité
à une condition de possibilité de l’objet. La praxis
de la science conçoit la vérité comme étrangère
à la sphère ontologique de la vérité vivante.
Cette auto négation de la vie est l’événement
crucial qui détermine la culture moderne en tant que culture scientifique,
phénomène qui va de pair avec l’élimination
des autres domaines spirituels.
Or tout homme se meut à l’intérieur du monde de la
vie, il est épreuve de soi, subjectivité, singularité.
Ce pathos fait partie de la vie qui s’auto transforme constamment
- travail sur soi ayant pour but l’individu, aspect jamais pris
en considération par la science. Voilà pourquoi vouloir
rompre le lien qui lie la vie avec elle-même est impossible. Telle
est la source de l’angoisse. L’hyper développement
de la science moderne constitue une des tentatives majeures de l’humanité
de fuir cette angoisse en même temps qu’il l’accroît.
L’occultation par l’homme de son être propre est au
principe de la barbarie.
Ch. V : Les idéologies de la barbarie
Il s’agit essentiellement des sciences humaines dont l’éclosion
caractérise la culture moderne. Ayant en vue l’homme lui-même,
elles prétendent à la vérité tout en faisant
abstraction de l’Individu transcendantal que nous sommes, mettant
hors jeu la subjectivité. Ces sciences sont donc sans objet, la
prolifération de leurs recherches n’est plus reliée
par une finalité unique. A leur vide thématique s’ajoute
l’anarchie de leurs méthodes qui singent celles des sciences
de la nature et du coup leur objet puisque toute méthode se définit
à partir de son objet. « Leur carence référentielle
»vient de ce qu’elles reposent sur une représentation
de la vie, une objectivation irréelle qui doit tout à cette
nature profonde de la vie – qu’elles méconnaissent.
Ainsi de l’histoire qui repose sur la relation de l’homme
à une Nature originelle, sensible et qui a besoin, en tant que
science de découper ses phénomènes sur le Fond ontologique
de l’historicité originelle, à laquelle elle emprunte
ses lois, sa motivation qui est lire sa propre essence, mais qui oublie
la qualité de son activité en prise sur des besoins subjectifs,
individuels, au nom de méthodes quantitatives.
Théoriquement les sciences humaines entretiennent donc une relation
incontournable à ce par quoi les hommes sont des hommes : corporéité,
langage, historicité, socialité etc. Mais l’objectivisme
de leur projet scientifique implique l’établissement d’idéalités,
un traitement de type mathématique qui appauvrit le fait humain.
Devant le suicide, la sexualité, l’angoisse, que valent des
statistiques ?
A cela s’ajoute la désignation arbitraire des caractères
essentiels qui ne sont plus temporalité, sensibilité, affectivité,
intersubjectivité etc. La thématisation au hasard, le traitement
quantitatif dénaturent la vie. Au pourquoi, on préfère
le comment. On construit un système des équivalences idéales
de la vie à partir non de la vie mais de sa représentation
irréelle. Plus on accumule de connaissances positives, plus on
ignore ce qu’est l’homme. Et pourtant la vie, écartée
à notre époque, n’en subsiste pas moins sous une forme
élémentaire, vulgaire, voire dans l’auto négation.
Ch. VI : Pratiques de la barbarie
La vie comme subjectivité possède un savoir qui est l’éthique,
la praxis coextensive à cette vie. Car la vie s’éprouve
comme valeur absolue, elle détermine les valeurs de son action
qui n’est que l’actualisation de son pouvoir primitif de corps
vivant. Son savoir ne diffère pas de son action et le mouvement
même de la vie pour persévérer dans son être
est auto affirmation. L’être de la subjectivité est
expérience continuée de soi, effort sans effort, accroissement
de soi qui ne demande rien à l’extérieur, immergé
dans sa « Nuit abyssale », étreinte où son pathos
se modalise selon les tonalités phénoménologiques
fondamentales du souffrir et du jouir. Souffrir, charge de soi qui n’a
rien d’empirique, poids de son existence propre incapable de se
défaire de soi. Jouir, quand la souffrance de la conservation se
change en ivresse de l’abondance.
Tel est le point source de toute culture comme de sa réversion
possible en barbarie. La subjectivité vivante étant force
contrainte de se prodiguer, la culture est l’ensemble des entreprises
et des pratiques dans lesquelles s’exprime la surabondance de la
vie. Cette condition ontologique est à l’origine des mythologies
comme distanciation des effrois originels, de la poésie comme délivrance,
elle habite en fait chaque besoin. Cette force, jamais niée en
son immanence radicale, ne se décharge pas, elle s’actualise.
Son action se porte à la hauteur du pathos de la vie afin d’accomplir
l’historial de celui-ci. Ces formes d’action à la mesure
de notre relation pathétique à l’être sont les
créations de la culture en tout domaine et pas seulement l’art.
Toute culture est donc libération d’une énergie, déploiement
de son être, accroissement qui lui permet d’être elle-même.
Elle ne se limite pas à des œuvres mais s’étend
à la vie tout entière.
La barbarie procède comme la culture de l’Energie originelle,
mais elle est l’inversion de cette énergie. Car l’élimination
de la vie n’est pas possible. Et c’est là qu’intervient
la responsabilité de la science qui a écarté d’elle
tout ce qui est subjectif. La culture en effet dispose le monde de façon
qu’il s’offre comme une image de son besoin d’accroissement
: habitat, tombes, édifices publics, tout cela qui permet à
l’homme de réaliser son essence, de sentir, de voir, d’aimer,
d’agir davantage. Mais dès que l’organisation du travail
par exemple ne s’enracine plus dans la subjectivité organique,
le travail devient insupportable, son mouvement reste bloqué dans
un souffrir qui ne se dépasse plus en jouir. L’énergie
ne subsiste que dans le refoulement, créatrice d’angoisse.
Elle cherche à se libérer par un soulagement immédiat,
se replie sous des formes frustes du sentir, du penser, de l’agir,
augmentant son mécontentement, engendrant la violence.
Les figures de la barbarie sont là, comportements grossiers, fuite
frénétique dans l’extériorité engendrant
l’échec à se débarrasser de soi, idéologie
scientiste, positiviste qui se substitue à la science, démission
de la vie transcendantale, engluement dans la télévision
qui est la vérité de la technique, avec sa recherche de
la brutalité du fait, l’incohérence de ses images
qui se substituent à la vie personnelle, sa censure idéologique
qui rassemble les stéréotypes d’une époque
etc.
Ch. VII : La destruction de l’Université
Primitivement destinée à transmettre la culture à
l’état pur et dotée à cet effet d’un
statut particulier, l’Université est aujourd’hui détruite
non seulement par la barbarie environnante mais par celle qui s’est
infusée dans ses méthodes. Le savoir qu’elle dispensait
signifiait entrée en possession de soi, même si ultérieurement
l’étudiant était soumis à l’activité
typée et stéréotypée d’une profession.
Aujourd’hui le développement de la culture le cède
à celui du développement technique autonome qui régit
la finalité de toute formation. Pour des raisons de débouchés,
l’individu est soumis à un conditionnement aliénant.
D’autre part c’est de l’intérieur que l’Université
est ruinée par l’idéologie de la technique La transmission
du savoir est soumise au leurre de la pédagogie qui substitue aux
riches contenus de la culture les prétendues conditions de son
enseignement, ce qui dispense tout le monde d’une culture véritable
– alors que la nature du vrai savoir, intemporelle, toujours contemporaine,
ne peut être transmise que si celui-ci est revécu par celui
qui le dispense. Devenue galiléenne, l’Université
ignore à son tour l’humanitas de l’homme.
Underground
Le rejet de la culture dans une clandestinité qui en change la
nature et la destination caractérise la modernité. Le propre
de cette barbarie moderne est de s’accomplir à l’intérieur
d’une forme de culture, le savoir scientifique. La négation
de la vie qui a pris l’allure d’un développement positif
aboutit en réalité au ravage de la Terre par la nature a-subjective
de la technique. Elle est également ruine de la communauté.
Car toute société repose sur une intersubjectivité.
Cette interaction des subjectivités implique la répétition
d’un savoir dans les formes supérieures de la culture et
pour le reste joue spontanément par intropathie et imitation L’abaissement
actuel vient de l’aliénation par les médias de l’ère
technicienne qui infusent l’hébétude à notre
société matérialiste. Ces médias sont totalement
étrangers à ceux de la culture qui aidaient l’homme
à se surpasser. C’est le règne de l’insignifiance,
de l’actualité, de la fuite dans la paresse intellectuelle.
Non contents d’ignorer la culture, ils imposent leurs valeurs et
leur insupportable ennui. Vouée à l’incognito, la
culture a été boutée hors de la Cité. «
Le monde peut-il encore être sauvé par quelques uns ? »