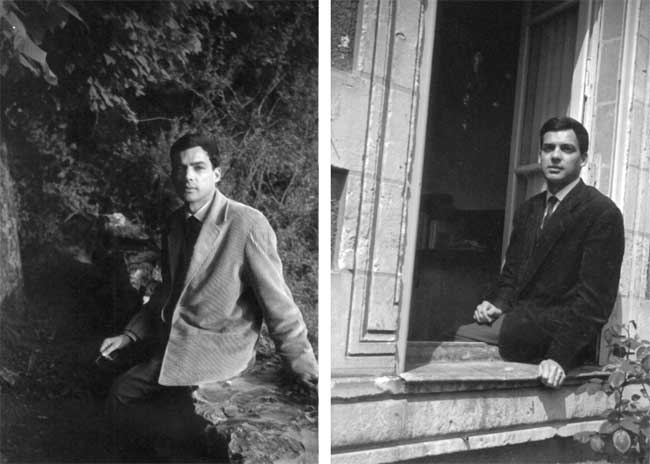L’essence de la manifestation - Ed.P.U.F.(1963)
PREFACE
INTRODUCTION : Le problème de
l’ego et les présuppositions fondamentales de l’ontologie
I - ELUCIDATION DU CONCEPT DE PHENOMENE
: LE MONISME ONTOLOGIQUE
II - TRANSCENDANCE ET IMMANENCE
III - LA STRUCTURE INTERNE DE
L’IMMANENCE ET LE PROBLEME DE SA DETERMINATION PHENOMENOLOGIQUE
: L’INVISIBLE
IV- INTERPRETATION ONTOLOGIQUE FONDAMENTALE
DE L’ESSENCE ORIGINAIRE DE LA REVELATION COMMME AFFECTIVITE
INDEX
IV INTERPRETATION ONTOLOGIQUE FONDAMENTALE DE L’ESSENCE ORIGINAIRE DE LA REVELATION COMMME AFFECTIVITE
Les premiers chapitres de cette section qui établit le caractère concret de la phénoménologie de l’immanence instaurent des notions capitales dont le choix et la signification eidétique rigoureuse sont propres à M.H. Elles dessinent une nouvelle topographie ontologique, fixent de nouveaux rapports. Concept central d’affectivité, dénommée aussi sentiment -au singulier-, sensibilité qui est déterminée par l’affectivité, passivité, souffrance, joie etc.
§ 52 Affectivité et ipséité
A partir de l’acquis, la structure de l’auto-affection est
l’immanence, M.H. établit une série de propositions:
« ce qui se sent sans que ce soit par l’intermédiaire
d’un sens est dans son essence affectivité ».Essence
de l’auto-affection, elle est celle de la révélation.
Toute expérience est expérience immédiate de soi,
c’est-à-dire ipséité dont l’essence ne
se réalise pas dans le temps. N’étant jamais le contenu
d’un sens, le sentiment ne peut être senti ni perçu,
il est pur sentiment de soi. A partir de ce fondement, toute représentation,
toute détermination de l’existence est affective. C’est
le soi originel et concret de l’affection, non le sujet logique
qui forme et rend possible l’opposition et la réception sur
le fond de leur identité affectant - affecté.
§ 53 L’affectivité comme passivité ontologique
originaire et l’effectivité de son essence dans le souffrir
L’affectivité est révélation de l’être
dans sa passivité originaire à l’égard de soi.
Cette passivité de l’ipséité signifie «
subir son être propre, se sentir soi-même tel qu’on
est dans l’identité absolue du se sentir et de ce qu’il
sent » - c’est cela qui forme l’épaisseur du
sentiment, sa transparence, son unité. Dans l’immanence du
sentiment, le sentir ne se dépasse donc vers rien, le Soi étant
le dépassement de Soi comme identique à Soi. Telle est son
impuissance et sa puissance puisque dans cette adhérence à
soi, il parvient en soi à la jouissance de son être propre.
En vertu de cette passivité ontologique, l’être de
l’action est non action, pas plus qu’il n’y a d’effort
dans le sentiment de l’effort. Etre un sujet veut donc dire subir,
veut dire être. Aucun romantisme en tout cela, il s’agit de
la structure interne de l’être, précise M.H. qui souligne
contre Heidegger : l’essence de la phénoménalité
ne se situe pas au-delà de son apparence mais la constitue. L’être
n’est invisible qu’en tant qu’il nous affecte.
§ 54 Interprétation ontologique de l’affectivité
comme fondement de l’affection. Le problème de l’affectivité
intentionnelle
En tant qu’immanence, l’affectivité est la condition
de la sensibilité, de la transcendance, le sentir n’étant
possible que sur le fond en lui du se sentir soi-même qui lui donne
sa réalité, l’ipséité rendant possible
l’affection par l’être étranger. Alors que l’affectivité
n’est jamais sensible, la sensibilité est constamment affective,
caractère qui rend possible son exercice, parce que le pouvoir
de l’opposition qui nous ouvre le monde comme affection de la transcendance
par le monde, a sa condition dans l’auto-affection et dans l’affectivité.
Tout rapport est affectif, tout comprendre est affectif de même
que toute image, en raison de ce lien de fondation. Critique de l’affectivité
intentionnelle.
§ 55 Détermination ontologique de l’affection
par l’affectivité.
Parce qu’elle rend possible la venue de ce qui arrive et le détermine
comme affectif, c’est l’affectivité qui fonde l’affection.
Elle se surordonne ainsi à la détermination des tonalités
de l’existence à partir de l’affectant. La tonalité
est une propriété de l’essence, sa modalité.
L’autonomie est l’essence de la vie en tant qu’elle
a le sentiment d’elle-même, c’est-à-dire qu’elle
peut être affectée. Telle est la passivité originelle
de l’être à l’égard de soi, et sa suffisance
en soi-même, l’essence de la non-liberté : dépendance
absolue à l’égard de soi ; indépendance absolue
à l’égard de l’être étranger. Analyse
du désespoir et de la béatitude selon Scheler. Rejet de
la thèse de Fichte sur le sentiment ainsi que de la psychologie
qui se dit scientifique. Toute destinée ne peut se comprendre que
comme historial de l’absolu, disait Lagneau.
§ 56 Affectivité et sensation
Mise au point du rapport affectivité – sensibilité
: erreur d’interpréter l’affectivité comme résultat
de la sensibilité. La réalité des sensations, jamais
individuellement isolables, est due non pas à leur somme mais à
leur être ensemble, ce qu’on appelle coenesthésie,
dont le contenu impressionnel subjectif dépasse la simple représentation
– sentiment général de l’existence dont le facteur
d’unité est l’affectivité, condition de toute
sensation, qui n’est réelle qu’en tant qu’elle
s’affecte elle-même, ce qui présuppose la dimension
ontologique de l’auto-affection et de l’affectivité.
Car la sensation n’est jamais extérieure, ce qui l’est
est sa référence à l’objet extérieur.
Elle a deux contenus, un contenu immanent, affectif et un contenu transcendant,
l’excitant. La sensibilité est donc à la fois affective
et représentative.
§ 57 L’affectivité comme forme universelle de
toute expérience possible en général et comme forme
de cette forme. Le concept pur de l’affectivité.
Dégradation simultanée des concepts de sensation et d’affectivité
dans la philosophie classique et dans l’existentialisme quand n’est
pas saisi l’être originel de la coenesthésie dont est
oublié le pouvoir ontologique de donation en tant que son être
est identique à l’affectivité. En réalité,
l’affectivité est la forme de toute expérience possible.
Critique de la conception cartésienne victime de son idéal
de connaissance pure, bien que soit reconnue l’existence du sentir
dans le cogito. Malebranche qui avait pressenti que pensée, conscience,
âme sont constituées par l’affectivité comme
forme a gâché son intuition par son interprétation
aberrante de la finitude de l’âme humaine.
§ 58 L’interprétation ontologique de l’affectivité
comme forme et comme affectivité pures et la problématique
kantienne du respect
Héritier d’une tradition qui fait de l’affectivité
le contenu de la sensibilité empirique, Kant considère le
sentiment comme « pathologique ». D’où l’escamotage
de la nature affective du respect dans la moralité qui doit exclure
l’élément empirique. Faute d’un concept pur
d’affectivité, il fait de la représentation de la
loi entendue comme coercition de tous les penchants la condition du respect.
Sa dévaluation de la vie entraîne sa méconnaissance
de la nature de l’action et de l’amour (religieux).
§ 59 L’affectivité comme pouvoir originaire
de révélation et la destruction de l’ensemble des
préjugés la concernant
Forme de l’expérience, l’affectivité est la
condition de tous les phénomènes, la manifestation. En tant
que surgissement originel de la phénoménalité, elle
rejette le néant, elle est l’existence. Révélation
de son être, elle est l’être, c’est-à-dire
qu’elle est Raison, fondement, ce qui pose « un nouveau concept
de l’esprit, comme identique à l’affectivité
» et oblige à congédier l’ensemble des préjugés
la concernant : elle est lumière et non opacité, impulsion
et non conscience, ce qui implique une nouvelle conception de l’action.
Critique de Malebranche et de Fichte définissant le sentiment comme
obscur.
§ 60 Détermination ontologique du pouvoir de l’affectivité.
1° Détermination du « comment de ce pouvoir : la vérité
de l’affectivité
Démonstration faite à propos de la douleur
§ 61 L’obscurité du sentiment et son langage.
Affectivité et pensée
Le Logos du sentiment dans son opposition à celui de la pensée.
L’affectivité révèle l’invisible et comme
cet invisible lui-même. Le sentiment est hors monde, insaisissable
de façon réflexive. Echec du monisme heideggérien
pour l’intégrer à des modes phénoménologiques
appartenant à l’objectivité du monde. L’effectivité
du sentiment est constituée par son obscurité principielle.
Le Logos originel n’attend pas de la pensée qu’elle
lui réponde ou qu’elle l’entende, « toujours
il dit ce qui est et son langage n’a pas d’histoire ».
§ 62 Détermination ontologique du pouvoir de l’affectivité.
2° Détermination du contenu de ce pouvoir : la réalité
du sentiment
Le principe de la différence qui existe entre nos divers sentiments
est identiquement celui de leur unité, l’affectivité
étant le principe de cette unité. Ils s’auto révèlent
selon l’affectivité mais l’acte de la transcendance
a sa révélation aussi : révélation du sentiment
à lui-même et manifestation de l’objet s’accomplissent
conjointement, le sentiment fondant la structure d’ensemble. Parce
que la transcendance trouve son essence dans l’auto-affection de
la relation qu’elle fonde, une telle relation se réalise
sous forme d’une tonalité déterminée, la détermination
du sentiment dans sa réalité particulière et variable
étant celle de la relation elle-même.
§ 63 La vérité du sentiment et le problème
des « sentiments faux » - qui ne sont que des sentiments
mal compris, ce qui ne met pas en cause le Logos de l’affectivité
. Critique de Merleau-Ponty et de Hegel.
§ 64 Le pouvoir de révélation de l’affectivité
selon Scheler et § 65 selon Heidegger
La détermination du pouvoir de révélation propre
à l’affectivité oblige la problématique à
rejeter toute philosophie qui assimile ce pouvoir à celui de l’intentionnalité
ou de la transcendance
§ 66 L’affectivité comme immanence. Etre originel
et être constitué du sentiment
Peut-on objecter à la compréhension de l’affectivité
comme immanence l’exception de « sentiments sensoriels »?
Scheler pensait que ceux-ci, se présentant dans le corps organique,
formaient une catégorie à part- ce qui est confondre révélation
de l’être originel du sentiment et représentation qui
est localisation. Rejet également de la thèse schelérienne
des niveaux affectifs.
§ 67 Affectivité réelle et irréelle
Même rejet quant à la possibilité selon Scheler de
ressentir des sentiments passés ou imaginaires ou d’habiter
la souffrance d’autrui. Dans les deux cas, il s’agit d’une
relation conçue comme intentionnelle, la conscience n’atteint
qu’une image et ne peut éprouver réellement le contenu
qu’elle se donne. Si la sympathie pour celui qui souffre est un
sentiment réel, elle diffère de la souffrance éprouvée
par l’autre dont le souffrir est auto révélation à
soi qui constitue son ipséité.
§ 68 Affectivité et action
Critique de la conception schelérienne qui reconnaît la relation
de l’affectivité à l’action ainsi que la puissance
créatrice de celle-ci mais qui ne conçoit cette relation
que par la médiation d’un troisième terme, le monde
des valeurs, que pour sa part Freud avait écarté. En fait,
l’action est l’existence même et son essence le pouvoir
qui la constitue, originellement éprouvé dans un Je peux.
L’affectivité est donc l’être de l’action,
leur relation est interne, immanente, c’est-à-dire absence
de relation.
§ 69 L’immanence radicale du sentiment et l’impossibilité
de principe d’agir sur lui
En tant qu’il est leur essence le sentiment ne saurait dépendre
du vouloir et de son exercice, de l’action ni être produit
par eux – puisqu’il les précède. Indépendance
reconnue par Luther ainsi que par la doctrine de la prédestination
et de la grâce, l’impuissance de l’homme devant Dieu
signifiant l’impuissance de l’action à l’égard
de l’affectivité. Critique de Spinoza qui a voulu soumettre
l’affectivité au pouvoir de l’homme, la placer sous
la dépendance du vouloir et de son action et pour cela la réduire
à des représentations.
§ 70 L’essence de la manifestation et les tonalités
fondamentales. Affectivité et absolu
L’indépendance absolue des tonalités affectives
à l’égard de l’action et de l’affection
oblige la problématique à chercher dans l’essence
même de l’affectivité. L’enracinement des tonalités
affectives fondamentales de l’existence dans l’essence de
l’affectivité, c’est-à-dire aussi bien de l’absolu
lui-même, explique leur partage dans les deux catégories
fondamentales de la souffrance et de la joie et la possibilité
du passage de la première à la seconde, la possibilité
pour ces tonalités de constituer ensemble quelque chose comme une
histoire. Mise en lumière d’un concept nouveau de la dialectique
comme dialectique immanente. Critique de la conception schelérienne
du rapport de la souffrance et de la béatitude. Interprétation
des thèses décisives de Kierkegaard sur le désespoir
et son rapport à la béatitude.
Caractère absolu de la révélation qui trouve
son essence dans l’affectivité par opposition à la
finitude de la manifestation qui s’accomplit dans la transcendance
du monde. Affectivité et absolu.
L’impuissance originelle du sentiment à l’égard
de soi, sa passivité, est le souffrir. Souffrance s’entend
donc comme adhérence parfaite à soi, l’obtention de
soi étant la jouissance, la certitude de l’ipséité.
Il s’agit de structures ontologiques. Le jouir est le mode selon
lequel l’être s’historialise dans le rassemblement édificateur
de la Parousie. L’unité de la souffrance et de la joie est
l’unité de l’être lui-même. L’histoire
de nos tonalités n’est autre que l’historial de l’absolu,
lui-même le passage et l’histoire – histoire originelle
qui ignore le temps de l’opposition et qui n’est ni dialectique
ni pour autant irrationnelle. Le Logos de vie est langage.
APPENDICE : MISE EN LUMIERE DU CONCEPT ORIGINAIRE DE LA REVELATION PAR OPPOSITION AU CONCEPT HEGELIEN DE MANIFESTATION (Erscheinung)
§ 71, Le problème de l’essence
de la manifestation et le déchirement, §72 La négativité
interprétée comme une catégorie de l’être,
§ 73 La pseudo essence de la subjectivité et la critique du
Christianisme, § 74 Le Royaume de la présence effective et
la fuite hors de toute effectivité, § 75 Le temps et le problème
de la manifestation du Concept, § 76 L’aliénation :
finitude et inadéquation de la manifestation objective, §
77 L’effort vers le savoir absolu.
Cet appendice historique prend pour thème la philosophie de
Hegel parce que celle-ci implique et d’une certaine façon
systématise les présuppositions fondamentales qui ont été
exposées sous le titre de Monisme ontologique. « L’hégélianisme
commande la philosophie moderne. Il n’a pas peu contribué
à donner à celle-ci sa physionomie propre, à lui
conférer ses caractères distinctifs : l’absence de
toute ontologie positive de la subjectivité, l’abandon de
l’homme au milieu absolu de l’extériorité, le
désespoir. » (p. 906)
Indépendamment de cet éclairage, ces chapitres constituent une étude magistrale de la pensée hégélienne, dominée en quelques dizaines de pages dans ses aspects les plus difficiles et sa signification ultime. Ils peuvent même être lus indépendamment de ce qui précède. Leur inclusion initiale dans L’essence de la manifestation a fait qu’ils n’ont jamais été l’objet d’une publication séparée.